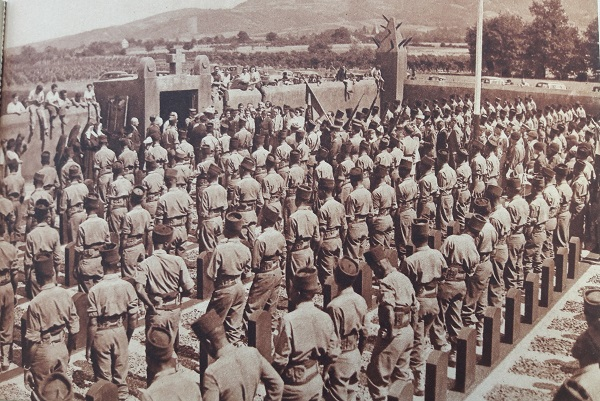Le 21 juillet 1857, Napoléon III signe le décret créant le premier bataillon du futur régiment des Tirailleurs sénégalais. Le texte soumis à l’Empereur par Louis Faidherbe, institutionnalisait ainsi une vieille tradition du XVIIe siècle, consistant à recruter des Africains pour servir dans les troupes coloniales. Cet acte s’inscrit dans le processus d’exécution de la mission confiée à Faidherbe, nommé gouverneur du Sénégal en 1854 : soumettre la vallée du fleuve à l’autorité politique française, au besoin par la force des armes. Le pouvoir colonial alors embryonnaire, ne pouvant compter sur des recrues européennes qui supporteraient difficilement les conditions climatiques et les pathologies tropicales, eut recours à un recrutement local. En dépit de sa dénomination, ses effectifs sont issus de toutes les colonies françaises d’Afrique au sud du Sahara. Pour le constituer et le maintenir en état de servir convenablement, l’Administration se heurta à une difficulté récurrente : la disponibilité des effectifs en hommes nécessaires à l’accomplissement de ses missions de défense, de conquête, de pacification et de maintien de l’ordre, dans divers théâtres d’opérations en Afrique, en Europe, en Indochine ou aux Antilles.
Les premiers contingents furent formés d’esclaves rachetés en Sénégambie ou libérés suite au décret abolitionniste de 1848. Déjà en 1823, le premier bataillon exclusivement africain est formé. Avec le scramble for Africa déclenché au lendemain de la Conférence de Berlin (1884-1885), la France eut plus que jamais besoin de « troupes noires ». Le corps des tirailleurs sénégalais a alors répondu présent sur tous les fronts où la France s’est engagée militairement durant la période coloniale. Dès 1827, un contingent de 200 « Sénégalais » est envoyé pour la conquête et l’occupation de Madagascar. En 1831, ils sont au nombre de 220 à débarquer en Guyane pour le maintien de la « paix ». Lorsque le Second Empire se lance à la conquête de la vallée du fleuve Sénégal, les tirailleurs sont largement mis à contribution. La République a suivi la voie ainsi tracée pour conquérir des territoires en Afrique au sud du Sahara et au Maghreb.
D’un millier d’hommes au début des années 1880, les effectifs passent à près de 6000 soldats à la fin du siècle. Outre le salaire payé et la fourniture de l’uniforme, la politique d’encouragement du volontariat a amené l’autorité coloniale à fermer les yeux sur les pillages opérés par les tirailleurs, à l’issue des victoires remportées sur les armées autochtones. Le recrutement s’accentue durant la période de « pacification » coloniale. Entre 1900 et 1911, le cap des 10.000 hommes est franchi.
La défaite des résistances africaines a permis de recycler nombre de leurs combattants dans les troupes coloniales. L’incorporation des enfants des souverains vaincus a contribué à changer l’image de l’armée coloniale. Le corps des Tirailleurs Sénégalais devenait attractif avec l’accès au salariat et à un statut social quelque peu enviable. Au début de la première guerre mondiale, 6 régiments de plus de 17.000 hommes constituaient le corps des tirailleurs sénégalais. Il a fallu l’intervention de Blaise Diagne, Commissaire de la République de l’Ouest Africain, pour atteindre, en 1917-18, le chiffre record de 63000 recrues qui ont contribué à la victoire de 1918 en payant un lourd tribut en hommes, plus de 30.000 morts avec de nombreux blessés et invalides de guerre. Les ressortissants des Quatre Communes de plein exercice, Saint-Louis, Gorée, Dakar et Rufisque refusaient d’intégrer le corps des tirailleurs estimant que le statut relevait du mercenariat. La loi du 19 octobre 1915 leur donna la possibilité de faire leur service militaire dans les rangs de l’armée régulière française.
Dans l’entre-deux-guerres, la conscription permit de résoudre de manière coercitive la question des effectifs. L’autorité en profita pour détourner le recrutement de ses objectifs militaires, en affectant une partie des recrues à des entreprises publiques ou privées.
Lorsque la deuxième Guerre mondiale éclate, plus de 100 000 Ouest-africains sont recrutés. Avec la débâcle de l’armée française, 24000 à 48000 combattants sont déclarés manquants dont plus de 15000 prisonniers en Allemagne. Par la suite, l’Afrique fournit aux Forces Françaises Libres plus de 100 000 hommes qui prennent part aux campagnes d’Afrique du Nord et d’Italie. En octobre 1944, les Tirailleurs Sénégalais sont le gros de la troupe au débarquement de Provence. A la libération, le bilan est lourd : 25.000 morts au combat et dans les camps nazis. Le recrutement s’est poursuivi jusqu’en 1960, pour faire face aux guerres de libération déclenchées en Indochine, au Cameroun et en Algérie.
Troupes noires, Spahis, Tirailleurs, Force noire, ainsi étaient nommés les soldats mobilisés pour des causes toujours étrangères. Tour à tour éclaireurs, guides, interprètes, main-d’oeuvre dans la construction de postes fortifiés et de chemins de fer mais surtout, force décisive dans les expéditions de conquête et de pacification, ils ont fait la guerre et payé lourd le fardeau des conflits d’Europe et d’ailleurs. Ballotés entre leurs villages d’origine, les pistes sablonneuses de ses savanes et les flots de l’océan, ils rejoignaient les guerres d’un continent lointain pour en assurer les lignes de défense pour la liberté promise et jamais octroyée.
C’est ici que s’est noué le drame d’une modernité de la chicotte que la France troquera dans ses colonies avec ses idéaux proclamés en métropole. C’est ici que la dépossession a commencé. Elle commence par l’apprentissage obligé d’une langue qui charrie des ordres qu’on est forcé de suivre. Elle se poursuit par la mise au rébus de la culture indigène qui cesse de servir de référence au profit de l’assimilation à une culture d’emprunt, ses ersatz et ses mirages. Elle finit par mettre nu des corps d’ébène pour leur faire arborer les habits de tirailleurs et tout l’attirail du soldat indigène.
Il convient de rappeler encore que les premiers tirailleurs ont été recrutés parmi les esclaves affranchis en 1848. Le fil subalterne de la liberté octroyée venait de se dessiner. Il se renouvèlera plusieurs fois avec une France qui se réserve toujours la liberté pour elle et les chaînes pour les autres. Le dilemme récurrent se nouait pour l’Hexagone qui se pose en champion de la liberté, de l’égalité et de la fraternité mais réservait l’exploitation, la subordination et l’assimilation pour ses colonies. La fabrique du subalterne devenait durant 2 longs siècles l’envers de son propre projet de libération. Elle s’épuisera dans ce dilemme dans lequel elle a continué de s’enfermer avant que ses illusions de domination impériale ne s’écroulent devant les Bastilles modernes de l’Afrique.
Qui n’a pas vu le fil bleu des libertés embastillées de 1848,1917,1946 et 1955. À chacune de ces dates, c’est du haut de l’arrogance de ses certitudes que la France distillait une « amère saveur de la liberté » aux Africains.
Les premiers tirailleurs libérés de l’esclavage étaient entraînés et encouragés à commettre des pillages et se partager le butin des sales guerres coloniales. Le butin de la citoyenneté allait suivre en 1917 avec la loi Blaise Diagne, alors que l’indigénat jetait les germes de l’apartheid colonial. La loi Lamine Gueye supprimait l’indigénat alors que se développait le « sur- jaunissement » des unités en Indochine. Des notes du début 1946 préconisaient, en Cochinchine, l’engagement de Cambodgiens. Au Tonkin, en 1948, le général Salan proposait et appliquait la même politique à l’égard des émigrés khmers, thaïs et chinois, des Chams musulmans du Sud Vietnam, des Moi composés de diverses ethnies (Rhadé, Bahnar…) et des Montagnards (Man, Méo, Muong, Tho…). Cela découlait d’une indigénisation du corps expéditionnaire qui accompagnait l’indigénisation de la citoyenneté dans l’empire coloniale.
A la fin de 1948, par exemple, le déficit de 26 000 hommes prévu pour 1949 fut limité à 7 000 hommes grâce au sur-jaunissement des unités en Indochine. Il s’y ajoutera un abaissement de leur statut militaire en octobre 1954. L’État-major procède à la dissolution et à la restructuration de nombreuses unités ainsi qu’à des changements d’appellation qui émeuvent les soldats les plus instruits. Les bataillons militaires africains (B.M.A) deviennent ainsi des bataillons de régiment d’infanterie coloniale ( R.I.C.). En octobre 1954, les B.M.T.S. N° 26, 27 et 28 deviennent les I, II et III/22ème R.I.C. ; les B.M. 1/A.O.F., B.M.2/A.C.F. et le B.M.3/A.O.F. forment les bataillons du 21ème R.I.C.
Thiaroye et les ressorts du Panafricanisme
Ils ont quitté les rives de l’Oubangui Chari, les bords de la Volta ou les méandres du Djoliba. Ils arboraient fièrement leur culture fulbe de Férobé, Ourourbé, Daïébé, Dialloubé ou évoluaient déjà en Rimaibé ou Torodbé1. Des communautés Soninke, Marka, Malinke, Bozo, Somono, Dogon et Bambara sédentarisées depuis des siècles, les rejoignaient dans la mobilisation des troupes avec les Wolof, Baynunk, Joola ou Susu2. Ils étaient, dans la nomenclature coloniale, les indigènes des territoires du Dahomey, de la Guinéens, de la Cote d’Ivoire, de la Mauritanie, du Niger, Sénégal, du Soudan (Mali) et de la Haute Volta (Burkina Faso). Ils étaient arrachés à leurs villages et soustrait au lent rythme de la vie quotidienne, où la distribution des terres de culture du terroir communautaire dépendait encore du chef de terre et des rites et rituels.
Sur les berges de l’océan atlantique, ils seront dépouillés de leur atours traditionnels et encagés dans des cantonnements et des camps. Ainsi commençait la longue dépossession de leur culture, de leur langue, et de leur liberté.
Le rapprochement est vite fait avec la hideuse odyssée de leurs ancêtres sur les mêmes quais du désespoir. Là, sur le sable fin des berges de l’Atlantique, un soldat spahi, soldat tirailleur a été dépouillé de son héritage de Fama, de Sofa ou de Gelëwar.
La détresse contenue de ce recrutement souvent forcé, nous ramène aux temps fatidiques de l’Atlantique du XVIIe siècle, lorsque la seule identité d’un homme noir était le nom d’un navire en mouvement sur les vagues sombres de l’océan. Pourtant il avait inventé l’humanité en Afrique depuis des millénaires avant de répandre son arc-en-ciel diasporique dans le monde entier. Le héros avait été auparavant cantonné sur les mêmes rivages et les mêmes quais, sous forme de paquets de chair noire, prêt pour l’embarquement. Là, juste sur les rives de la mer, leur mémoire, leur culture et leur histoire allaient leur être déniées et transformées en désespoir d’un exil forcé.
L’océan avait repris pour eux le service funèbre des bateaux de l’esclavage et de la servilité. Il devenait le locus même où s’élaboraient les nouvelles identités subalternes et l’embrigadement de nations entières dans les bataillons des « damnés de la terre ». L’analogie est saisissante entre la « force noire » de Mangin3 et l’odyssée des « boat in motion4 ». Sur les berges de l’océan s’inventait une nouvelle géographie entre les terroirs de l’intérieur, les comptoirs de la côte et les mouroirs de l’océan Atlantique.
Dans leur nouvel attirail, leur nouveau jargon, leur nouveau statut, ils allaient se faire imposer un des destins les plus tragiques du XXe siècle. 1843, 1914, 1939, chacune de ces dates est un appel fatidique sur les fronts d’une guerre qui n’était pas la leur. On leur promettait la liberté et l’égalité comme le prix de leur bravoure mais les chaînes du subalterne seront la seule rançon de leur courage au combat. Ils se distingueront dans les batailles des Dardanelles au débarquement de Provence, servant souvent de boucliers assurant les arrières des armées françaises.
La tragédie de Thiaroye fait écho à tous ces drames des temps modernes pour tout le Continent avec ces voyages au loin, dont l’horizon s’est toujours prolongé dans l’impasse des promesses non tenues de la France et l’Europe occidentale pour la liberté, la fraternité universelle et l’égalité des peuples. Sur le sol métropolitain comme sur les territoires de la colonie, ils ont porté tout le fardeau de la liberté et de la construction de la modernité sur leurs épaules. Ils ont alimenté l’Europe et l’Amérique de leur sang et de leur sueur avant de les verser dans les guerres d’une France pressée d’arborer les habits de la gloire impériale.
De leur exil forcé dans les Amériques, les Balkans et les Vosges, ils ont forgé avec Sylvester Williams, Blyden, Padmore ou Dubois l’hymne héroïque de la libération nationale et du panafricanisme.