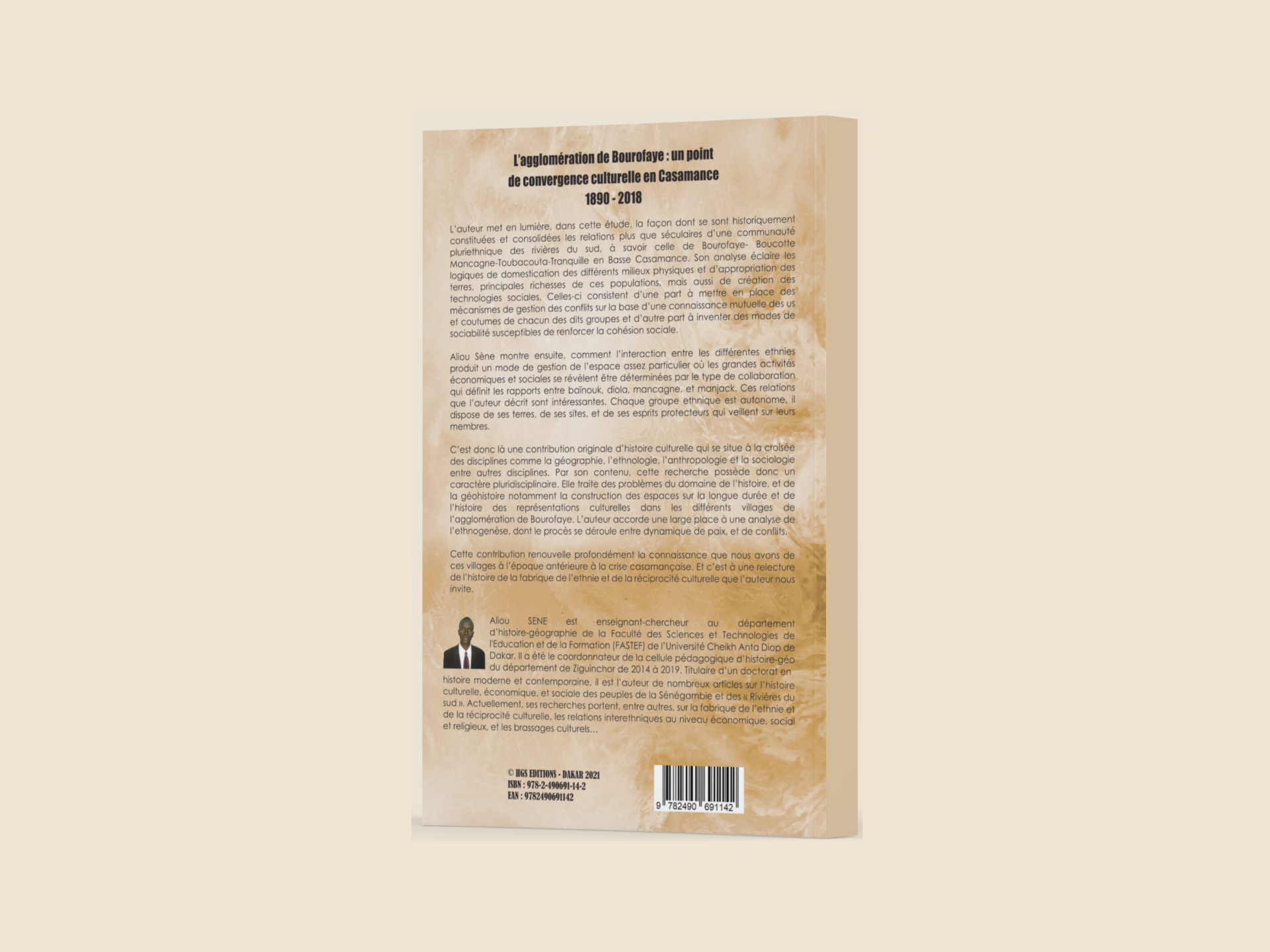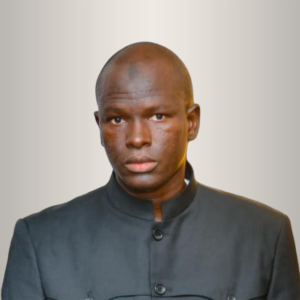L’auteur met en lumière, dans cette étude, la façon dont se sont historiquement constituées et consolidées les relations plus que séculaires d’une communauté pluriethnique des rivières du sud, à savoir celle de Bourofaye- Boucotte Mancagne-Toubacouta-Tranquille en Basse Casamance. Son analyse éclaire les logiques de domestication des différents milieux physiques et d’appropriation des terres, principales richesses de ces populations, mais aussi de création des technologies sociales. Celles-ci consistent d’une part à mettre en place des mécanismes de gestion des conflits sur la base d’une connaissance mutuelle des us et coutumes de chacun desdits groupes et d’autre part à inventer des modes de sociabilité susceptibles de renforcer la cohésion sociale. Aliou Sène montre ensuite, comment l’interaction entre les différentes ethnies produit un mode de gestion de l’espace assez particulier où les grandes activités économiques et sociales se révèlent être déterminées par le type de collaboration qui définit les rapports entre baïnouk, diola, mancagne, et manjack. Ces relations que l’auteur décrit sont intéressantes. Chaque groupe ethnique est autonome, il dispose de ses terres, de ses sites, et de ses esprits protecteurs qui veillent sur leurs membres. C’est donc là une contribution originale d’histoire culturelle qui se situe à la croisée des disciplines comme la géographie, l’ethnologie, l’anthropologie et la sociologie entre autres disciplines. Par son contenu, cette recherche possède donc un caractère pluridisciplinaire. Elle traite des problèmes du domaine de l’histoire, et de la géohistoire notamment la construction des espaces sur la longue durée et de l’histoire des représentations culturelles dans les différents villages de l’agglomération de Bourofaye. L’auteur accorde une large place à une analyse de l’ethnogenèse, dont le procès se déroule entre dynamique de paix et de conflits. Cette contribution renouvelle profondément la connaissance que nous avons de ces villages à l’époque antérieure à la crise casamançaise. Et c’est à une relecture de l’histoire de la fabrique de l’ethnie et de la réciprocité culturelle que l’auteur nous invite.